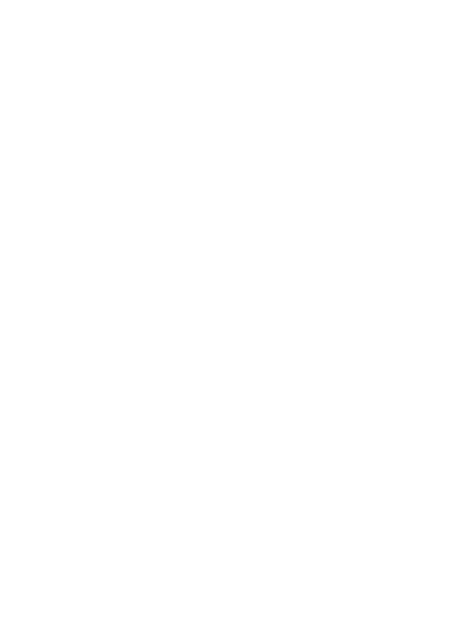vendredi 14 septembre 2012 à 21h :
vendredi 14 septembre 2012 à 21h :
The Artist
de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo et John Goodman
France | Hommage au cinéma | 2011 | 1h40 | Noir et Blanc
Prix d’interprétation masculine du 64ème Festival International Du Film De Cannes 2011 pour Jean Dujardin
Sept récompenses aux Bafta 2012 : dont Meilleur film, Meilleur acteur pour Jean Dujardin, Meilleur Scénario Original, Meilleure Musique et Meilleur réalisateur.
Prix du meilleur film européen aux Prix Goya 2012 Du Cinéma Espagnol
Six récompenses à la 37e Cérémonie Des César 2012 : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleure Actrice pour Bérénice Béjo, Meilleure Musique, Meilleure Photographie et Meilleurs Décors.
Quatre récompenses aux Spirit Awards 2012 : meilleure photographie, du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius, du meilleur acteur pour Jean Dujardin et du meilleur film.
Cinq récompenses (sur 10 nominations aux Oscars) à la 84ème Cérémonie Des Oscars 2012 : meilleur acteur pour Jean Dujardin, meilleure création de costumes, meilleur réalisateur, meilleure bande originale et meilleur film.
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle être propulsée au firmament des stars…
« Beau, The Artist l’est, assurément. Trop ? Jamais. Car peut-on dire d’un mot d’amour qu’il est « trop » beau, « trop » juste ou « trop » sincère ? Non. Ainsi, au-delà, bien au-delà de l’exercice de style (réussi) salué par la profession, le film de Michel Hazanavicius se révèle être un tonitruant « Je t’aime » au Septième Art. La formule peut paraître excessive tant elle a pour habitude d’être galvaudée, pourtant, que dire d’autre ?
Si ce n’était qu’une simple (!) affaire de maîtrise technique, The Artist serait déjà une belle copie d’élève appliqué : rigueur du jeu des acteurs et de la mise en scène, soin religieux apporté à la photographie et à la reconstitution historique, tout y est. Cependant Hazanavicius va heureusement plus loin et ceux qui s’étaient risqués à prendre le cinéaste et son acteur pour deux rigolos vont en être pour leurs frais. Le récit de la chute et de la rédemption de George Valentin offre certes un hommage vibrant aux grands classiques du muet (tristement rares sur nos écrans plats), fondateurs du cinéma d’hier et d’aujourd’hui, mais il rend surtout compte de la constante évolution à la fois grisante et effrayante d’un art aussi cruel que généreux, en perpétuelle mutation, … et pourtant toujours magique ». Eléonore Guerra / Comme au cinéma.com
La force du film réside non pas tant dans la précision de la reconstitution que dans l’engagement d’un cinéaste qui a crû en sa tentative et qui s’est donné les moyens d’en réussir le pari. Ce film phénomène est un hommage radieux au cinéma.
1 court métrage :
RUBIKA
de Margaux Vaxelaire
France | 2010 | 4′
Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité fracassante.
 vendredi 28 septembre 2012 à 21h :
vendredi 28 septembre 2012 à 21h :
Sleepy Hollow
de Tim Burton
d’après le roman de Washington Irving
avec Johnny Depp (Ichabod Crane), Christina Ricci (Katrina Van Tassel), Miranda Richardson (Lady Van Tassel), Casper Van Dien (Brom Van Brunt), Christopher Walken (Headless Horseman), Lisa Marie (Lady Crane) et Martin Landau.
Etats-Unis | Fantastique | 2000 | 1h45 | VOST
En 1799, dans une bourgade de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement retrouves décapités. Terrifiés, les habitants sont persuadés que ces meurtres sont commis par un étrange et furieux cavalier sans tête. Les autorités new-yorkaises envoient alors leur plus fin limier pour éclaircir ce mystère.
Ce chef-d’œuvre de Tim Burton fait rêver, entraîne le spectateur dans un monde terrifiant et merveilleux. C’est un conte noir pareil à ceux de l’enfance.
Sleepy Hollow est une immense psychanalyse dans laquelle, sous le bruit des sabots et des cavalcades, il faut percevoir les indices plus dérangeants d’une enfance traumatisée. Le voyage d’Ichabod est une cure psychanalytique (Sleepy Hollow : le trou endormi, propice à l’interprétation des rêves ! ) qui lui permet d’assimiler le Cavalier sans tête à son père et de le renvoyer définitivement sous terre. Katrina lui permet d’exorciser la crainte paternelle qui voyait le mal sous le masque de la vertu. Libéré de ces maléfices, Ichabod pourra entrer libre dans le monde adulte. A la fin du « Cavalier sans tête », Ichabod Crane aura trouvé femme, enfant et richesse ; la violence du choc subit le fait ainsi échapper à l’échec que connaissaient jusqu’à présent les héros de Tim Burton, tant Edward que Batman, Jack Skellington ou Ed Wood, mélancoliques profonds et dépressifs inguérissables.
Tim Burton a opéré deux transformations majeures par rapport à la nouvelle (voir rappels historiques plus bas). Il a donné une existence réelle au Cavalier sans tête qui n’est qu’un leurre dans le texte d’Irving Washington et il a inventé les personnages de la mère et du père dont le souvenir vient troubler le sommeil du héros.
Dans l’un de ces rêves figure un plan du père sans tête. L’escamotage de la tête passe presque inaperçu et se fait dans le changement de plan entre le père vu de face et le père vu de dos lorsqu’il pénètre dans la chambre de torture. Mais ce plan signifie bien qu’en élucidant son enquête, le jeune détective se confronte surtout avec le souvenir douloureux et enfoui de ses parents. En ayant censuré le souvenir de son ordure puritaine de père (les termes sont de Burton) et celui d’une mère à l’amour ambigu, Ichabod est, au début du film, un héros fragile, une silhouette costumée dans la tradition de Sherlock Holmes, un détective (mal et sur) mené par son cerveau. Il est protégé par tout un arsenal bricolé qui fonctionne plutôt mal et le couvre de sang à la moindre tentative.
Se débarrasser du souvenir du père est peut-être la tâche la plus facile ; s’il n’a plus de tête c’est d’abord parce que c’est la tête de la mère qui a pris toute la place. Lorsque le jeune Ichabod pénètre dans la chambre des supplices de son père, dont il gardera des stigmates sur la main, c’est le regard de sa mère qu’il voit dans La Vierge de Fer. Ce même regard sera celui que l’enfant de la sage-femme verra au travers des lattes du plancher lorsque le Cavalier aura décapité sa mère.
Car il faut aussi que la mère meure, du moins symboliquement. Son souvenir est certes apparemment plus serein que celui du père. Ichabod se souvient avoir dansé avec elle dans une forêt printanière et enchantée. Mais ses jeux l’inquiétaient tout autant que les signes cabalistiques qu’elle traçait devant la cheminée. Ichabod enfant partageait les doutes de son père. Et lorsqu’il est sur le point de partir de Sleepy Hollow, il fait subir à son fils de substitution le même message glacial transmis par son père : c’est sous le masque de la vertu que se cachent les pires démons.
Certes à la sortie du rêve du père à la tête coupé, Katerina est littéralement donnée à Ichabod pour lui faire oublier sa mère. Mais Il faudra toute la tendre attention de Kathrina et son petit livre bleu, pour qu’il découvre le véritable sens des signes tracés. L’amour de Katrina est alors sanctifié par la bonne mère, celle de la jeune fille qui lui avait donné ce livre de sorcellerie protectrice. La mère d’Ichabod se révéle alors, elle auss,i immédiatement protectrice. Le jeu d’optique en carton sur lequel figurent une cage et un oiseau, permet en effet à Ichabod de trouver la coupable : l’image unique de la femme sans tête à la main blessée doit être décomposée entre le corps de la servante Sarah et le geste intentionnel de la belle-mère. Par contre le mauvais père et la mauvaise mère (La belle-mère de Katrina est aussi un personnage inventé par Tim Burton) sont renvoyés aux enfers.
La neige qui tombe sur New-York est le dernier symbole du film, il renvoie aux fleurs blanches qui baignaient la mère. Mais il s’agit cette fois d’une manifestation de la pure nature qui tombe comme une bénédiction sur le couple et leur enfant adoptif. Le plan final montrant les héros de dos s’engageant dans une avenue de New-York redouble cet optimisme puisqu’il renvoie à la figure classique de la fin heureuse inaugurée par Chaplin dans « Les temps modernes ».
1 court métrage :
SIGNALIS
de Adrian Flückiger
Suisse | 2008 | 5′
Ce film d’animation inventif nous fait pénétrer dans un étrange triplex que baigne, d’étage en étage, les lumières rouge, orange et verte bien connues.
 vendredi 12 octobre 2012 à 21h
vendredi 12 octobre 2012 à 21h
BULLHEAD
de Michael R. Roskam
avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy, Barbara Sarafian, Tibo Vandenborre
Drame policier | Belgique | 2011 | 2h09
Jacky est issu d’une importante famille d’agriculteurs et d’engraisseurs du sud du Limbourg. A 33 ans, il apparaît comme un être renfermé et imprévisible, parfois violent… Grâce à sa collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jacky s’est forgé une belle place dans le milieu de la mafia des hormones.
Alors qu’il est en passe de conclure un marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants d’hormones de Flandre occidentale, un agent fédéral est assassiné. C’est le branle-bas de combat parmi les policiers. Les choses se compliquent pour Jacky et tandis que l’étau se resserre autour de lui, tout son passé, et ses lourds secrets, ressurgissent…
Succès local
Sorti en Belgique en février 2011, Bullhead a créé la surprise au box-office flamand en cumulant pas moins de 460 000 spectateurs.
Entrainement intensif
Le comédien Matthias Schoenaerts, dont le talent est confirmé depuis le succès du film de Jacques Audiard De rouille et d’os, a pris plus de 27 kilos de muscles pour se glisser dans la peau de son personnage, le baraqué Jacky Vanmarsenille.
Un cinéma belge grandissant
Longtemps critiqué pour sa lenteur et son manque d’originalité, le cinéma belge semble pourtant en belle et grande forme, et ce surtout depuis quelques années (L’Enfant en 2005, Dikkenek en 2006, La Merditude des Choses et Mr. Nobody en 2009…). En proposant une intrigue « mafieuse » dans le contexte original du trafic d’hormones, Bullhead confirme clairement cette tendance.
Cours de dialectes
Pour les besoins du film, Matthias Schoenaerts et les autres comédiens ont dû étudier différents dialectes de la petite ville de Saint-Trond et de Flandre occidentale qu’ils ont, au final, parfaitement assimilés.
Certaines scènes du film, tournées en patois régionaux flamands dans un but d’authenticité, ont donc suscité un sous-titrage de dialogues entiers, également pour le reste de la Flandre.
Trafic d’hormones
Si Bullhead délaisse le point de vue de l’enquête policière, le film s’attarde principalement sur l’organisation des réseaux illégaux du trafic d’hormones dans le milieu de l’élevage bovin. Une pratique qui interpelle les consciences belges depuis 1995 et l’affaire Van Noppen, dans laquelle un vétérinaire, soupçonné de participer à des affaires mafieuses, avait été assassiné. Toutefois, le réalisateur Michael R. Roskam a déclaré qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une adaptation de l’affaire, mais bien d’une fiction s’en inspirant : « Bullhead traite de la mafia des hormones comme « Hamlet » traitait de la royauté danoise ! », s’amuse-t-il.
Oscars
Le film belge Bullhead a été sélectionné pour concourir dans la catégorie du « Meilleur Film Etranger » lors de la cérémonie des Oscars 2012.
Les critiques
« Bullhead s’impose en force comme une révélation tonitruante » Le Nouvel Observateur
« On peut certes trouver qu’une fois lancé à fond sur les rails de la fatalité (sentimentale) le film perd un peu de son mystère initial. Le réalisme devient poétique et la dimension policière s’estompe. L’essentiel est l’impression que produit le film, le sentiment que Michaël R. Roskam a réalisé un des plus beaux films noirs européens vus depuis longtemps » Les Inrockuptibles
« Bullhead est une œuvre très impressionnante. Un polar de chemins de traverse qui avance à son rythme, entre scènes suspendues et fulgurances violentes » L’Express
« Film noir aux influences américaines évidentes, Bullhead prend à bras-le-corps une intrigue qui ne ferait pas injure au fin fond d’un patelin du Midwest, où obscurantisme, frustration sexuelle et violence à fleur de peau font le meilleur des ménages » Libération
« Abrupt et brutal, ce thriller flamand sert de toile de (mauvais) fond au portrait d’un homme rustre, frustre et frustré dont, peu à peu, nous sera dévoilé le drame originel » Paris-Match
« Si Bullhead permet ainsi la révélation d’un acteur d’exception, il signe aussi un premier essai en forme de remarquable maîtrise technique » Ecran Large
« Un premier long métrage étouffant et dérangeant, qui nous en met plein la tronche » CinemaTeaser
« Une réalisation époustouflante souligne l’interprétation de Matthias Schoenaerts. Bullhead mêle avec brio le polar, la description du monde paysan et le drame intimiste » Le Figaroscope
« Avec son héros tragique en quête de rédemption, ce thriller brutal, sélectionné à l’Oscar du meilleur film étranger, accroche le spectateur sans le ménager » Le Parisien
un court métrage
Avaler des couleuvres
de Jurgis Krasons
Lettonie | 2010 | 10′
Il était une fois, dans un village, des intellectuels « ronds ». Ils étaient futés, aimables, prévoyants et couronnés de succès. La raison de leur succès était dans leur capacité à avaler des couleuvres. Dans ce village vivaient aussi des habitants « carrés ». Eux, étaient des réalistes pragmatiques.
Ils étaient terre à terre et n’avalaient point de couleuvres. Ils vivaient tous en paix jusqu’au jour, où les « carrés » découvrirent que les « ronds » avalaient des couleuvres.
Si les Français avalent de couleuvres, les Lettons préfèrent les crapauds, les plus gras et répugnants possibles. Mais l’efficacité est la même : au moindre affront, il suffit d’en gober un et la pilule passe jusqu’à l’offense suivante. Par un coup de crayon agité et un ton résolument subversif, Jurgis Krasons s’amuse des limites de la tolérance et des comportements passifs. En maniant habilement l’humour noir, l’ironie et la violence trash, il signe une parabole cruelle et absurde évoquant l’œuvre de Roland Topor ou de Bill Plymton. Un régal !
Carrière du film :
Festival international du film (Cannes / France – 2010)
Festival d’animation (Ottawa / Canada – 2010)
Anima Mundi (Rio de Janeiro / Brésil – 2010)
Festival du film de Milan (Milan / Italie – 2010)
Festival international du film d’animation (Séoul / Corée – 2010)
 vendredi 26 octobre 2012 à 21h
vendredi 26 octobre 2012 à 21h
La prisonnière du désert
de John Ford
avec John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond et Natalie Wood
Etats-Unis | Western | 1956 | 1h59 | VOST
Texas, 1868. Des Comanches attaquent le ranch d’Aaron Edwards, qui est tué ainsi que sa femme et son fils. Ethan, le frère d’Aaron, apprenant le drame, part à la recherche de Lucy et Debbie, ses deux nièces disparues, accompagné de Martin Pawley et Brad Jorgensen…
Un accueil chaleureux mais une consécration tardive
À sa sortie, le 13 mars 1956, le film ne fut pas considéré comme le chef-d’œuvre qu’il est aujourd’hui, même si les critiques l’ont dans l’ensemble bien accueilli. Il a fallu attendre 15 ans pour qu’il figure dans la prestigieuse liste Sight and Sound du British Film Institute, la liste des meilleurs films de tous les temps.
Une source d’inspiration pour de nombreux réalisateurs
Cinquante ans après sa sortie en 1956, La prisonnière de désert de John Ford est devenu une figure emblématique du paysage cinématographique. « Avant de commencer un tournage, je regarde toujours quatre films, généralement : Les Sept Samourais, Lawrence d’Arabie, La vie est belle et La prisonnière du désert », confie Steven Spielberg.
Martin Scorsese en a souvent parlé, le citant parmi ses films préférés, comme une œuvre dont il continue à se nourrir. Il en a d’ailleurs utilisé un extrait dans son chef-d’œuvre de 1973, Mean Streets, et Taxi Driver (1976) porte la marque de l’influence du film de John Ford.
L’influence de La prisonnière du désert est perceptible dans des films très différents tels que Star Wars, Rencontres du Troisième Type, Kill Bill ou Impitoyable, pour n’en citer que quelques-uns.
John Ford et sa relation avec les Indiens
Beaucoup d’historiens du cinéma ont débattu de la signification réelle de La prisonnière du désert, spéculant sur la véritable nature du racisme du héros Ethan et commentant les idées de John Ford sur les Indiens. Peter Bogdanovich interrogeait un jour John Ford sur sa façon de traiter les Indiens dans ses films.
« C’est un peuple très digne, même quand il est vaincu. Évidemment, ce n’est pas très bien vu aux Etats-Unis. Le public aime que les Indiens se fassent tuer. Il ne les considère pas comme des êtres humains, des hommes ayant une grande culture, très différente de la nôtre. Pourtant, en y regardant de plus près on s’aperçoit qu’en fait leur religion est très proche de la nôtre », avait répondu Ford.
En plus de tout ce qui a été écrit sur la façon dont les amérindiens sont présentés dans le film, La prisonnière du désert continue de susciter des discussions enflammées et de faire l’objet d’innombrables analyses depuis sa redécouverte au début des années 70 par une nouvelle génération de cinéphiles et de cinéastes.
Le tournage
Le tournage a eu lieu pendant l’été 1955 dans des endroits extrêmement pittoresques comme Monument Valley (à la frontière entre l’Arizona et l’Utah) que Ford avait déjà utilisé dans des classiques comme La Chevauchée fantastique ou encore La Poursuite infernale. La prisonnière du désert est la 9ème collaboration de John Ford et John Wayne sur un long métrage, depuis que le réalisateur avait sorti l’acteur de l’anonymat, le propulsant en 1939 au rang de star avec son grand classique, La Chevauchée fantastique.
Alors qu’il est en passe de conclure un marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants d’hormones de Flandre occidentale, un agent fédéral est assassiné. C’est le branle-bas de combat parmi les policiers. Les choses se compliquent pour Jacky et tandis que l’étau se resserre autour de lui, tout son passé, et ses lourds secrets, ressurgissent…
Succès local
Sorti en Belgique en février 2011, Bullhead a créé la surprise au box-office flamand en cumulant pas moins de 460 000 spectateurs.
Entrainement intensif
Le comédien Matthias Schoenaerts, dont le talent est confirmé depuis le succès du film de Jacques Audiard De rouille et d’os, a pris plus de 27 kilos de muscles pour se glisser dans la peau de son personnage, le baraqué Jacky Vanmarsenille.
Un cinéma belge grandissant
Longtemps critiqué pour sa lenteur et son manque d’originalité, le cinéma belge semble pourtant en belle et grande forme, et ce surtout depuis quelques années (L’Enfant en 2005, Dikkenek en 2006, La Merditude des Choses et Mr. Nobody en 2009…). En proposant une intrigue « mafieuse » dans le contexte original du trafic d’hormones, Bullhead confirme clairement cette tendance.
Cours de dialectes
Pour les besoins du film, Matthias Schoenaerts et les autres comédiens ont dû étudier différents dialectes de la petite ville de Saint-Trond et de Flandre occidentale qu’ils ont, au final, parfaitement assimilés.
Certaines scènes du film, tournées en patois régionaux flamands dans un but d’authenticité, ont donc suscité un sous-titrage de dialogues entiers, également pour le reste de la Flandre.
Trafic d’hormones
Si Bullhead délaisse le point de vue de l’enquête policière, le film s’attarde principalement sur l’organisation des réseaux illégaux du trafic d’hormones dans le milieu de l’élevage bovin. Une pratique qui interpelle les consciences belges depuis 1995 et l’affaire Van Noppen, dans laquelle un vétérinaire, soupçonné de participer à des affaires mafieuses, avait été assassiné. Toutefois, le réalisateur Michael R. Roskam a déclaré qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une adaptation de l’affaire, mais bien d’une fiction s’en inspirant : « Bullhead traite de la mafia des hormones comme « Hamlet » traitait de la royauté danoise ! », s’amuse-t-il.
Oscars
Le film belge Bullhead a été sélectionné pour concourir dans la catégorie du « Meilleur Film Etranger » lors de la cérémonie des Oscars 2012.
Les critiques
« Bullhead s’impose en force comme une révélation tonitruante » Le Nouvel Observateur
« On peut certes trouver qu’une fois lancé à fond sur les rails de la fatalité (sentimentale) le film perd un peu de son mystère initial. Le réalisme devient poétique et la dimension policière s’estompe. L’essentiel est l’impression que produit le film, le sentiment que Michaël R. Roskam a réalisé un des plus beaux films noirs européens vus depuis longtemps » Les Inrockuptibles
« Bullhead est une œuvre très impressionnante. Un polar de chemins de traverse qui avance à son rythme, entre scènes suspendues et fulgurances violentes » L’Express
« Film noir aux influences américaines évidentes, Bullhead prend à bras-le-corps une intrigue qui ne ferait pas injure au fin fond d’un patelin du Midwest, où obscurantisme, frustration sexuelle et violence à fleur de peau font le meilleur des ménages » Libération
« Abrupt et brutal, ce thriller flamand sert de toile de (mauvais) fond au portrait d’un homme rustre, frustre et frustré dont, peu à peu, nous sera dévoilé le drame originel » Paris-Match
« Si Bullhead permet ainsi la révélation d’un acteur d’exception, il signe aussi un premier essai en forme de remarquable maîtrise technique » Ecran Large
« Un premier long métrage étouffant et dérangeant, qui nous en met plein la tronche » CinemaTeaser
« Une réalisation époustouflante souligne l’interprétation de Matthias Schoenaerts. Bullhead mêle avec brio le polar, la description du monde paysan et le drame intimiste » Le Figaroscope
« Avec son héros tragique en quête de rédemption, ce thriller brutal, sélectionné à l’Oscar du meilleur film étranger, accroche le spectateur sans le ménager » Le Parisien
1 court métrage
Guard Dog
de Bill Plympton
Etats-Unis | 2004 | 5′
Pourquoi les chiens aboient-ils après des créatures innocentes telles que les pigeons et les écureuils ? Ce film répond à cette question éternelle.
 vendredi 9 novembre 2012 à 21h
vendredi 9 novembre 2012 à 21h
La Party
de Blake Edwards
avec Peter Sellers, Claudine Longet et J. Edward McKinley
Etats-Unis | Comédie burlesque | 1969 | 1h39 | VOST
Invité par erreur dans une très chic soirée hollywoodienne, un figurant indien sème un désordre indescriptible.
Blake Edwards n’est pas seulement le plus grand réalisateur de comédies qui ait prolongé l’âge classique hollywoodien. Il restera celui qui, durant les arides années 1960, aura maintenu à une hauteur inespérée les grands et petits récits du cinéma américain en raison, certes, de son sens de la comédie (La Panthère rose, Mais qu’as-tu fait à la guerre, Papa ?), du vaudeville trivial (Victor, Victoria) et du burlesque débridé (The Party, Boires et Déboires), mais aussi de l’action (Allo… brigade spéciale, Deux hommes dans l’Ouest, Opération clandestine), du drame (Le Jour du vin et des roses) ou des histoires d’amour teintées de mélancolie (Diamants sur canapé, Top Secret).
Peut-être dans l’esprit ambiant de redécouverte de la culture des années soixante-dix, La Party est aujourd’hui devenu, en France, un film-culte. Les chiffres de sa dernière ressortie en juin 2001 dans deux salles parisiennes et en province sont, à cet égard, significatifs (près de 15 000 entrées en 3 mois). Pourtant, le film, peu remarqué et critiqué pour sa « vulgarité » à sa première sortie en 1969, semble toujours susciter quelque perplexité au sein d’une partie du public. Objet à part, La Party semble, de fait, hésiter entre le registre des irrésistibles Laurel et Hardy et celui des comédies modernes. L’humour déployé par Blake Edwards et son acteur fétiche Peter Sellers a donc pu être, au choix, jugé passéiste ou, au contraire, en avance sur son temps… Pourtant, les références qui viennent à l’esprit en voyant le film sont bien Mon oncle (1958) ou Playtime (1967) de Jacques Tati, doublés – et pimentés –, dans La Party, d’une critique du milieu du cinéma à Hollywood dans les années soixante. C’est d’ailleurs sur ce point que La Party prend peut-être le plus ses distances avec le grand public français, se rapprochant naturellement davantage d’un public de cinéphiles. En effet, La Party appartient aussi à la grande famille des films et comédies sur le cinéma. Mais ce deuxième niveau de lecture ne doit, en aucun cas, gâcher l’appréciation de l’art de faire rire.
La Party est un film audacieux aux allures de défi : réussir un film burlesque à la fin des années soixante, parvenir à réaliser une œuvre en grande partie muette (mais sonore) à un âge très avancé du cinéma. Misant sur l’expérimentation et l’improvisation, Blake Edwards se devait de trouver un principe fédérateur pour organiser le chaos d’un film certes scénarisé, mais dont l’existence même dépendait bien peu de ce qui était couché sur le papier. D’où un tournage sur le fil du rasoir, reposant entièrement sur la confiance unissant le cinéaste et son acteur principal ; d’où l’importance accrue des questions de mise en scène. Edwards fit de l’enchaînement logique la condition même de la progression de l’action, tant au plan de l’histoire racontée qu’à celui du passage d’un plan, d’une séquence, d’une série ou d’un thème à l’autre. Ce principe a pour corollaire la lenteur de la mise en place de l’histoire comme des situations, et surtout des gags qui méritent quasiment tous d’être intégrés à la famille royale des procédés du cinéma comique : le slow burn, le gag « à combustion lente », si l’on suit la lettre de la langue anglaise, qui implique en effet longueur et lenteur dans la préparation comme dans la réalisation – et dont la finalité, depuis Mack Sennett, Chaplin et surtout Laurel et Hardy, est la pure et simple destruction. Un tel but est bien celui de La Party, du moins dans sa dominante subversive à l’encontre d’une certaine image d’Hollywood et de l’Amérique.
1 court métrage
Paradise
de Jesse Rosensweet
Canada | 2007 | 8′
Paradise raconte l’histoire d’un homme dont les actes sont régis par le destin et qui est contraint de suivre un chemin tracé d’avance. Dépourvu de jugement, John Small rêve à un avenir meilleur mais ne savoure jamais le moment présent. Il est optimiste, ambitieux et dévoué. John est absorbé par son travail et sa routine quotidienne.
Jesse Rosensweet fait partie d’une nouvelle vague de conteurs. Ses histoires sont à la fois drôles et sombres, échevelées et sérieuses. Son style personnel tire parti des particularités de l’animation image par image pour créer des films d’un attrait universel. Après avoir remporté le prix du Jury à Cannes en 2002 pour le court métrage Stone of Folly, Jesse Rosensweet nous revient avec Paradise, mettant en scène une ville métallique américaine des années 50 où les habitants en fer-blanc vont et viennent dans la joie et l’obéissance. Tout paraît prédéterminé par les rails sur lesquels évoluent les personnages. Dans cet univers de métal où les gens se déplacent allègrement et docilement, tels de véritables jouets, John Small n’a aucune prise sur son existence et comme dans la vie réelle, cela va le perdre.
Carrière du film :
Festival international du film d’animation (Annecy / France – 2008)
Festival international du film court (Dresde / Allemagne – 2008)
Festival international du film d’animation (Stuttgart / Allemagne – 2008)
Festival international du film (Jérusalem / Israël – 2008)
Festival international du film d’animation (Hiroshima / Japon – 2008)
Cinanima (Espinho / Portugal – 2008)
Festival international du film pour enfants (Chicago / Etats-Unis – 2007)
Festival international du film (Stockholm / Suède – 2007)
Festival international du court métrage (Berlin / Allemagne – 2007)
Festival international du film (Vancouver / Canada – 2007)
Cinéfest (Sudbury / Canada – 2007)
Festival international d’animation (Ottawa / Canada – 2007)
Festival international du film (Calgary / Canada – 2007)
 vendredi 30 novembre 2012 à 21h
vendredi 30 novembre 2012 à 21h
A bord du Darjeeling Limited
de Wes Anderson
avec Owen Wilson, Adrien Brody et Jason Schwartzman
Etats-Unis | Comédie dramatique | 2008 | 1h47 | VOST
Trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père décident de faire ensemble un grand voyage en train à travers l’Inde afin de renouer les liens d’autrefois. Pourtant, leur quête spirituelle va vite dérailler, et ils se retrouvent seuls, perdus au milieu du désert avec onze valises, une imprimante, une machine à plastifier et beaucoup de comptes à régler avec la vie…
A l’apogée de son art, Wes Anderson réussit sa délocalisation indienne. Il signe un film à la fois visuellement sublime et semble plus à l’aise que jamais avec ses thèmes favoris. Chaque plan est une carte postale qui respire cette nostalgie sereine chère au réalisateur. On retrouve tous les ingrédients qui ont fait la renommée d’Anderson, rythme saccadé qui ne rechigne jamais à s’emballer, répliques mémorables (« Voulez-vous venir fumer une cigarette avec moi dans les toilettes ? »), situations décalées, bande son impeccable… Ne perdant rien de sa sensibilité, Anderson prouve une nouvelle fois ses qualités de guide en offrant au spectateur des plans-séquences ralentis, laissant l’action se dérouler comme dans un rêve. Vibrant hommage au cinéma indien des années 1960, et de Satyajit Ray en particulier, Anderson se démarque de ses contemporains par sa maîtrise exceptionnelle du cadre. Ses travellings n’ont rien perdus de leur créativité, donnant au film des senteurs de poésie indienne – en conformité avec les clichés occidentaux diront ses détracteurs – mais criants de cette vérité si particulière, exposée depuis dix ans dans les œuvres de ce cinéaste définitivement inclassable.
Tournage indien
Le film a été tourné en grande majorité dans le désert du Rajasthan, au nord-ouest du sous-continent indien, région riche en palais. Le Darjeeling Limited se déplaçait sur des rails reliant la cité de Jodhpur à celle de Jaisalmer, en passant dans le désert de Thar qui se trouve le long de la frontière pakistanaise. L’orphelinat et couvent de Patricia a été créé dans la verte et luxuriante ville d’Udaipur, dans un ancien pavillon de chasse royal qui appartenait autrefois au Maharana de Mewar, un des souverains de l’ère Rajput.
Où le film a pris sa source
C’est en regardant Le Fleuve de Jean Renoir que Wes Anderson s’est découvert une passion pour l’Inde.
Voyage organisé
Malgré la passion de Wes Anderson pour l’Inde, il n’avait jamais visité le pays avant la production du film. C’est en mai 2006, pendant l’écriture du scénario, qu’il s’y est rendu pour étoffer l’histoire et fignoler les personnages.
Névroses familiales
Les histoires de familles ont toujours été au cœur du cinéma de Wes Anderson : La Famille Tenenbaum en 2002, La Vie aquatique en 2005 et Moonrise Kingdom en 2012 en sont les exemples les plus révélateurs. A bord du Darjeeling Limited n’échappe à la règle puisqu’il évoque la relation de trois frères profondément marqués par le décès de leur père un an auparavant.
Jouer différemment
Adrien Brody évoque la direction d’acteur de Wes Anderson : « Dans la scène de la rivière, les indications que me donnait Wes Anderson étaient complètement à l’opposé de ce que j’aurais fait en temps normal. Je devais paraître presque absent, sans émotion visible et parfaitement neutre, un jeu très différent de ce que j’envisageais de faire. Cela rendait la scène plus triste car elle souligne l’incapacité de mon personnage à faire face à la situation ».
Angelica Huston / Wes Anderson : 3ème !
A bord du Darjeeling Limited marque la 3ème collaboration entre Wes Anderson et Anjelica Huston. Malgré leur complicité, l’actrice fut surprise par le rôle qu’il lui a proposé : « Cette femme a laissé derrière elle sa famille pour devenir une bonne sœur, ce qui constitue un changement de vie plutôt radical, explique Huston. Je dois dire que j’adore voir des religieuses au cinéma. J’ai toujours été fan du film Au risque de se perdre, dans lequel Audrey Hepburn joue une sœur. Il y a aussi un film de mon père que j’adore, Dieu seul le sait, dans lequel Robert Mitchum affronte une religieuse jouée par Deborah Kerr. Vers l’âge de six ans, je voulais même entrer dans les ordres, mais c’est une envie qui m’est vite passée ! Néanmoins, je trouve que ce sont des personnages fantastiques, il y a en elles quelque chose de romantique qui m’a toujours beaucoup touchée ».
A bord des plateaux de tournage
Wes Anderson a tenu absolument à ce que les scènes du train soient filmées dans un véritable train, excluant un tournage en studio. Une décision qui sonnait comme un véritable défi pour toute l’équipe et plus particulièrement pour le chef décorateur : « J’avais déjà travaillé en Inde pour le tournage de Un nom pour un autre de Mira Nair, raconte Mark Friedberg. Nous avions filmé une journée dans un train et je savais que le tournage de A bord du Darjeeling Limited n’allait pas être des plus faciles ! Malgré toutes les difficultés logistiques inhérentes à un tel exercice, Wes n’a jamais changé d’avis. Nous sommes donc allés dans une région de l’Inde gérée par la Northwestern Railways et nous leur avons annoncé que nous avions besoin de dix wagons et d’une locomotive que nous allions entièrement redécorer et faire rouler sur leur réseau ferré. C’était la première fois qu’on leur demandait une telle chose. Les démarches ont été longues et fastidieuses, mais nous avons fini par obtenir ce que nous voulions ».
La vie ferroviaire
Le chef décorateur Mark Friedberg évoque le train dans lequel se déroule la première partie du film : « Au final, notre train allie le style de ceux que l’on peut voir en Inde, le luxe d’un train de grande ligne comme l’Orient Express et la modernité des trains de passagers européens. Nous nous sommes aussi inspirés du 20th Century Limited, le célèbre express américain qui a relié New York à Chicago de 1902 à 1967. La décoration du train mélange des motifs du Rajasthan, les couleurs de l’Indian Railways et le style Art Déco ; tout a été fait à la main dans la plus pure tradition indienne ».
Le saviez-vous ?
Le réseau ferroviaire indien s’est développé à partir du 19ème siècle et est aujourd’hui l’un des plus fréquenté au monde avec près de 15 millions de passagers quotidiens.
1 court métrage
Bisclavret
de Emilie Mercier
France | 2011 | 14′
Une Dame, épouse d’un Baron, s’aperçoit que son mari s’absente souvent et le questionne : il lui avoue qu’il se dénude et devient Bisclavret. Transformé en loup, il saccage, pille et tue. Effrayée et prise de dégoût, la Dame révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps.
Elle s’offre à lui et lui demande de récupérer les habits du Baron pendant l’une de ses sorties nocturnes, le condamnant ainsi à errer sous son aspect animal.
Émilie Mercier, formée à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles puis à l’école des Gobelins, souhaitait depuis longtemps réaliser un film d’animation inspiré de l’art du vitrail. La découverte du Lai de Bisclavret de la poétesse Marie de France lui donna l’opportunité de développer son projet esthétique en restant fidèle au poème moyenâgeux. Pour cette adaptation, la réalisatrice a peint à l’encre les décors et les personnages avant de les scanner et de les animer comme des pantins de papier découpé. La couleur et la naïveté du graphisme ainsi que la narration, en vers, rendent grâce à cette chanson de geste qui se dispense de toute morale. Ainsi, Emilie Mercier a su conserver le mystère de Bisclavret et préserver toute l’ambivalence des personnages pour restituer aux spectateurs un conte résolument moderne.
Carrière du film :
Festival international de cinéma jeunes public en Val-de-Marne Ciné Junior (Itinérant / France – 2012)
Plein la bobine Festival de cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy (La Bourboule / Mont-Dore / France – 2011)
Festival International du Court Métrage (Lille / France – 2011)
Festival du premier court métrage (Pontault-Combault / France – 2011)
Festival international du film d’animation (Krok / Ukraine – 2011)
Festival international du film d’animation (Annecy / France – 2011)
Festival international du film pour enfants (Chicago / Etats-Unis – 2011)
Festival international Nouveaux cinéma nouveaux médias (Montréal / Canada – 2011)
Festival international du cinéma d’animation Cinanima (Espinho / Portugal – 2011)
Festival national du film d’animation (Bruz / France – 2011)
 vendredi 7 décembre 2012 à 21h
vendredi 7 décembre 2012 à 21h
avec Amnesty International
Une bouteille à la mer
de Thierry Binisti
avec Agathe Bonitzer, Mahmoud Shalaby, Hiam Abbass, Riff Cohen et Jean-Philippe Écoffey
France | Canada | Israël | Drame | 2012 | 1h39
Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi. Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre que seule la haine peut régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service militaire. Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux « Gazaman »…
Les critiques
« Le film rend attachantes la spontanéité des personnages, leur manière de s’approprier le conflit israélo-palestinien sans se laisser dicter des réponses par les adultes ». Télérama
« Malgré sa naïveté pacifiste un brin encombrante, voici une chronique racontée, filmée et interprétée avec une vraie grâce ». VSD
« orté par la vérité de jeu d’Agathe Bonitzer et la magnétique présence de Mahmoud Shalaby, ce beau film est chaque minute plus captivant et porteur d’un espoir pas du tout flottant ». Le Parisien
« Une certaine grâce et un vrai sens de l’observation des personnages » Première
« Ce film destiné à un jeune public a le mérite de s’attaquer à l’un des centres nerveux de l’actualité ». Positif
Un film d’après un roman épistolaire
« Une bouteille dans la mer de Gaza », de Valérie Zenatti, dont est tiré le film, est à la fois un roman à « deux voix » (Tal et Naïm se font tour à tour narrateur et s’expriment à la première personne) et un roman épistolaire, leurs lettres étant ici des courriers électroniques. Ce double registre leur permet ainsi de s’adresser directement l’un à l’autre et de faire partager au lecteur tant leur regard sur cet échange épistolaire que des informations sur leur vie quotidienne, leur sentiments…
Le roman par lettre est aussi vieux que la littérature. Le poète Ovide a recouru à ce procédé dès le Ier siècle avant J-C avec ses « Héroïdes », recueil de lettres d’amour de femmes célèbres à leur amant (Pénélope à Ulysse, Hélène à Pâris…). Il peut avoir un seul scripteur, voix unique qui s’adresse directement à un ou plusieurs interlocuteurs sans que ceux-ci puissent lui répondre. C’est le cas de « Il faut qu’on parle de Kevin », de Lionel Shriver (adapté au cinéma en 2011 par Lynne Ramsay). Une femme y adresse une série de lettres à son ancien mari à propos de leur fils, et rétablit « sa » vérité sur ce qui est arrivé à leur famille.
Le roman épistolaire peut prendre la forme d’un échange entre deux interlocuteurs, voire plus. Un exemple célèbre (adapté au cinéma notamment en 1988 par Stephen Frears et en 1989 par Milos Forman) est le roman de Choderlos de Laclos, « Les liaisons dangereuses » (1782). Sur le thème des relations amoureuses, il réunit les lettres d’un ensemble de protagonistes, les libertins et leurs « proies ». Il offre ainsi une multiplication des points de vue sur les mêmes événements. Le roman épistolaire peut également permettre à un auteur de se dissimuler derrière des scripteurs imaginaires pour faire passer ses propres idées. Mais au-delà de l’intention et du sens portés par le choix et le nombre de scripteurs, au-delà même de la facture du récit, le roman épistolaire possède une autre caractéristique : par le style de celui qui rédige, l’auteur nous permet de cerner sa psychologie, son niveau culturel, ses aspirations, nous offrant, par-delà le discours, une appréhension plus intime du ou des personnages.
1 court métrage
Tôt ou tard
de Jadwiga Kowalska
France | 2008 | 5′
Deux mondes entrent en collision. un écureuil rencontre une chauve souris solitaire. Ensemble, ils essaient de remettre de l’ordre dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la nuit, et de bien plus encore.
La mécanique du temps est bien rodée mais il suffit d’un rien pour la dérégler. C’est une noisette qui va semer le chaos dans la petite routine de deux animaux occupant le même arbre et amenés, par nature, à ne jamais se croiser. Partagé entre le jour et la nuit, l’écran devient le théâtre de la rencontre improbable de ces deux compagnons d’infortune. Utilisant du papier découpé et faisant preuve d’une inventivité visuelle remarquable, Jadwiga Kowalska signe un conte sur la réconciliation et l’amitié qui émerveillera les petits et réconfortera les plus grands.
Carrière du film :
Festival Anima (Bruxelles / Belgique – 2011)
Stuttgarter Filmwinter (Stuttgart / Allemagne – 2011)
Festival international du film (La Rochelle / France – 2010)
Un festival c’est trop court (Nice / France – 2010)
Festival cinéma d’Alès « Itinérances » (Alès / France – 2009)
Eléphant d’or « Travelling » Festival de cinéma de Rennes (Rennes / France – 2009)
Prix du public Festival du film (Zürich / Allemagne – 2008)
Prix spécial du jury Festival international du film court (Téhéran / Iran – 2008)
Prix du meilleur film en 35 mm Festival international de court métrage (Oberhausen / Allemagne – 2008)
Circuito Off (Venise / Italie – 2008)
Festival du film de Vendôme (Vendôme / France – 2008)
Séquence Court-métrage (Toulouse / France – 2008)
Ferstival Cinanima (Espinho / Espagne – 2008)
Festival Européen du Film Court de Brest (Brest / France – 2008)
Festival international du documentaire et d’animation (Leipzig / Allemagne – 2008)
Festival national et international du court métrage (Clermont-Ferrand / France – 2008)
Festival international du film d\’animation (Annecy / France – 2008)
 Vendredi 18 janvier 2013 à 21h
Vendredi 18 janvier 2013 à 21h
La part des anges
de Ken Loach
avec Paul Brannigan, Gary Maitland, Jasmin Riggins Mo et William Ruane
Grande-Bretagne | Comédie dramatique | 2012 | 1h41 | VOST
à Glasgow, Robbie, un jeune père de famille, est sans arrêt rattrapé par son passé de délinquant. Il échappe à la prison de justesse, mais est condamné à un travail d’intérêt général. Un éducateur, Henri, lui est assigné. Il devient son nouveau mentor qui l’initiera secrètement à l’art du whisky. Robbie intègre l’univers des distilleries et se découvre des dons cachés pour la dégustation de spiritieux.
La Part des anges (The Angels’ Share) a obtenu le Prix du Jury au Festival de Cannes 2012. Cinéaste social plutôt spécialisé dans le drame, Ken Loach provoque ici la surprise en optant pour la comédie. Il montre les efforts d’un jeune Écossais violent, récemment devenu père, cherchant à s’insérer dans le jeu social. Le chemin de la rédemption passe curieusement par la découverte des grands whiskies. L’intrusion dans le monde des gens convenables met au jour des règles troubles. L’expression « La part des anges » désigne le volume d’alcool qui s’évapore durant le vieillissement en fût.
1 court métrage
Cassus Belli
de Georgios Zois
Grèce | 2010 | 11′
Toutes sortes de gens, de nationalité, de classe, de sexe et d’âge différents font la queue dans sept files d’attente. La première personne de chaque file devient la dernière de la suivante, formant une gigantesque chaîne humaine.
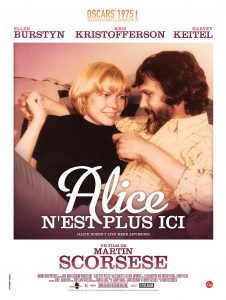 vendredi 8 février 2013 à 21h
vendredi 8 février 2013 à 21h
Alice n’est plus ici
de Martin Scorsese
avec Ellen Burstyn, Kris Kristofferson et Harvey Keitel
Etats-Unis | Romance dramatique | 1975 | 1h52| VOST
Alice, âgée de huit ans, rêve de devenir une star… 27 ans plus tard, elle est mariée et mère d’un insupportable gamin. A la mort de son mari, elle part chercher du travail comme chanteuse, et se retrouve serveuse de snack. La chance de sa vie apparaît enfin sous les traits de David, un propriétaire de ranch divorcé.
Quarante-cinq ans après son premier film, on s’est fait à l’idée que Martin Scorsese est le cinéaste des hommes prisonniers de leur destin. Raison de plus pour aller voir son quatrième long-métrage, sorti en 1975, histoire d’une femme qui prend la route et sa vie en main. Le film procure aussi tous les plaisirs d’un road movie américain des années 1970 : les grands espaces, le rock’n’roll et des acteurs qui s’épanouissent dans leur liberté toute neuve, en l’occurrence Ellen Burstyn, Kris Kristofferson et – déjà – Jodie Foster.
1 court métrage
Citrouilles et vieilles dentelles
de Juliette Loubières
France | 2010 | 8’46
Un photographe de pub est contraint de chercher dans une maison de retraite une bonne tête de papy pour une affiche.
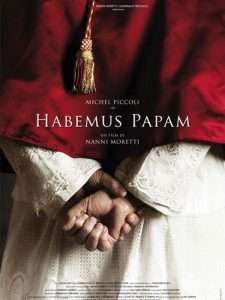 vendredi 22 février 2013 à 21h
vendredi 22 février 2013 à 21h
Habemus Papam
de Nanni Moretti
avec Michel Piccoli, Nanni Moretti et Jerzy Stuhr
Italie | France | Comédie dramatique | 2011 | 1h42 | VOST
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité.
Habemus Papam s’avère sans doute être le film où cohabitent de la façon la plus inextricable et équilibrée les différents pôles morettiens : la mélancolie et l’irruption du burlesque, l’entreprise de réenchantement de l’existence et le difficile exercice de la responsabilité individuelle parmi une collectivité. Une ode inspirée à la liberté individuelle, une réflexion mordante sur les aléas du pouvoir, une critique chronique de la psychanalyse, un composé très subtil de drôlerie et de mélancolie.
1 court métrage
Flamingo pride
de Tomer Eshed
Allemagne | 2011 | 6′
Agacé d’être le seul hétérosexuel de son groupe, un flamand rose tombe amoureux d’une cigogne qui vole au-dessus de lui.
 vendredi 22 mars 2013 à 21h
vendredi 22 mars 2013 à 21h
Drive
de Nicolas Winding Refn
avec Ryan Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston
Etats-Unis | Thriller | 2011 | 1h40 | VOST
Un jeune homme solitaire, « The Driver », conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant – et au volant, il est le meilleur ! C’est alors que la route du pilote croise celle d’Irene et de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il n’est plus seul…
Porté par une musique pop comme sortie des années 1980, Drive (Prix de la Mise Scène au Festival de Cannes 2011) multiplie les ralentis et réussit un mariage improbable entre la romance la plus délicieusement fleur bleue et un déchaînement de violence qui rappelle le cinéma sud-coréen. Le film condense tous les attraits du film noir : personnage laconique, atmosphère inquiétante et séduisante, tension permanente, interprétation époustouflante et réalisation bluffante. Enfin, le charme du film repose également sur la présence magnétique de l’angélique Ryan Gosling, déjà remarqué dans Danny Balint, La Faille, Half Nelson, Blue Valentine, Les Marches du Pouvoir ou encore Crazy Stupid Love.
1 court métrage
En pleine forme
de Pierre Etaix
France | 1971 | 2′
Un jeune homme fuit la grande ville et cherche une place dans un camping. Mais dans quel camp, exactement, est-il tombé ?
Et comment en sortir ?
 vendredi 29 mars 2013 à 21h
vendredi 29 mars 2013 à 21h
La piel que habito
de Pedro Almodovar
avec Antonio Banderas, Elena Anaya et Marisa Paredes
Espagne | Drame | 2011 | 1h57 | VOST
Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Douze ans après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette peau…
Un justaucorps couleur chair qui recouvre entièrement un corps féminin courbé au-dessus d’un coussin. Le tableau vivant qui ouvre La piel que habito est une espèce de programme. Une deuxième peau à la texture repoussante, aux coutures apparentes. Comment passer de cette enveloppe artificielle, qui porte la marque de l’industrie des hommes, à l’illusion de la nature, une peau aussi tiède et souple que celle d’une jeune femme ? A cette question, le docteur Robert Ledgard (Antonio Banderas) a trouvé la réponse. Le personnage central du nouveau film de Pedro Almodovar est un savant, un génie, il est fou, comme les docteurs Frankenstein et Moreau. Et comme le réalisateur, pris ici d’une furie d’expérimentation, qui se lance dès les premiers plans de La piel que habito (« La peau que j’habite ») dans une opération à haut risque – à la fois greffe et dissection. Celle-ci met en danger le film, remet en question la raison d’être du cinéma. Au bout du compte, les deux patients ressortent pleins d’une vie nouvelle.
Comme il aime à le faire depuis longtemps, Almodovar commence par désarticuler le temps. Dans ses derniers films (La Mauvaise Education, 2004, Volver, 2006, ou Etreintes brisées, 2009), les époques finissaient par s’emboîter pour ne plus former qu’un seul récit. La piel que habito ne parviendra pas à cette fluidité. Délibérément, les transitions sont à la fois brutales et prévisibles. La trajectoire du docteur Ledgard est très simple à tracer : il a perdu sa femme et sa fille. Son travail sur la chirurgie esthétique et la création d’une peau artificielle et son expérimentation sur un sujet humain cherchent à réparer ces dommages immenses.
1 court métrage
We ate the Children last
de Andrew CividinoCanada | 2011 | 13′
Des chercheurs découvrent un remède radical pour les maladies des voies digestives par la transplantation d’organes de porc dans le corps humain ! Une interprétation sans faille, une maitrise de l’image et un montage qui ne suit pas toujours la chronologie de l’histoire, contribuent à l’efficacité de ce film.
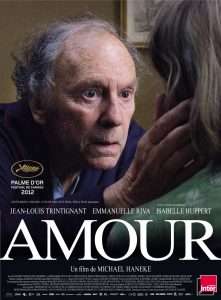 vendredi 5 avril 2013 à 21h
vendredi 5 avril 2013 à 21h
Amour
de Michael Haneke
avec Emmanuelle Riva, Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert et Alexandre Tharaud
France | Autriche | Drame | 2012 | 2h07
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.
La peinture s’invite, dans un montage splendide qui suspend le temps, laisse galoper l’imagination vers des rives lumineuses. Ce film porté par une foi dans l’homme et dans le libre arbitre accueille aussi une forme de mystère. C’est là toute sa beauté. Le Monde
Le spectateur sera pris à la gorge par ce cinéma dur et droit, débarrassé de toutes les fanfreluches. Tout cela transforme un simple film en chef-d’œuvre inoubliable. Le Parisien
Dans un huis-clos somptueux, Haneke affronte la terreur de la mort à travers le dernier face-à-face d’un très vieux couple. Libération
Trintignant et Riva, personne ne pouvait mieux dire cet amour-là que ces deux extraordinaires solistes. Marianne
Amour est constamment touchant. Un intense film de couple, une radiographie aussi précise qu’universelle de cette partie de nos existences qu’on appelle « la fin de vie ». Les Inrockuptibles
Plus de 40 prix prestigieux ont salué le film de Michael Haneke dont :
2012 : Festival de Cannes : Palme d’or
2013 : BAFTA Awards : Meilleure actrice pour Emmanuelle Riva et Meilleur film étranger
2013 : Prix Méliès du meilleur film français
2013 : Césars du cinéma :
Meilleur film
Meilleur réalisateur pour Michael Haneke
Meilleure actrice pour Emmanuelle Riva
Meilleur acteur pour Jean-Louis Trintignant
Meilleur scénario original pour Michael Haneke
2013 : Oscars du cinéma : Meilleur film en langue étrangère
1 court métrage
Une leçon particulière
de Raphaël Chevènement
France | 2007 | 10′
Cyril, dix-sept ans, prend un cours particulier de français avec Eva,
vingt-sept ans. Ils étudient un poème d’amour de Victor Hugo.
 vendredi 12 et samedi 13 avril 2013 à 20h30
vendredi 12 et samedi 13 avril 2013 à 20h30
26ème Festival du Court Métrage de Vélizy-Villacoublay
Ciné-Concert et Compétition Nationale
1988 – 2013 : 25 ans de Festival
vendredi 12 et samedi 13 avril à 20h30
organisé et animé par le Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay
produit par l’Onde, théâtre et centre d’art de Vélizy-Villacoublay
vendredi 12 avril à 20h30 :
Ciné – Concert de Serge bromberg
Ce passionné de cinéma racontera des anecdotes sur des trésors de cinémathèque et accompagnera au piano des films rarement visibles. Cette nouvelle programmation a pour but de rassembler parents et enfants, cinéphiles et curieux, qui vont découvrir par exemple le Destino de Walt Disney réalisé avec Salvador Dali en 1946, quelques bijoux de Walter Lantz, qui n’est autre que le formateur d’un certain Tex Avery, ou de Winsor McCay, l’un des pionniers du cinéma d’animation.
Samedi 13 avril à 20h30 :
Compétition Nationale
| 12 films français en compétition pour le Prix du Public et le Prix du Jury
| comédie, drame, fantastique, animation, insolite et action
| projection en présence des cinéastes et d’un jury de professionnels
| palmarès communiqué en fin de soirée
Un seul mot d’ordre : faire rire, étonner et émouvoir. C’est-à-dire rassembler le meilleur de la production française récente, en privilégiant l’originalité et le spectaculaire.
lieu de projection :
Centre Maurice Ravel | salle Raimu
25, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay
tarifs uniques :
la soirée : 11 € | forfait 2 soirées : 16 €
réservations conseillées à l’Onde : 01 34 58 03 35
coproduction :
l’Onde, théâtre et centre d’art de Vélizy-Villacoublay, avec le soutien de la ville de Vélizy-Villacoublay et du Conseil Général des Yvelines
 vendredi 31 mai 2013 à 21h
vendredi 31 mai 2013 à 21h
Les adieux à la reine
de Benoît Jacquot
avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen et Noémie Llovsky
France | Drame historique | 2012 | 1h40
En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend…
« Une débâcle misérable et mesquine, assez jubilatoire par sa mise en scène cruelle et crépusculaire » Libération
« Benoît Jacquot signe un film au charme entêtant comme un parfum qui mêle à la vie quotidienne foisonnante les signaux secrets de l’histoire, annonçant un changement d’époque » Le Figaro
1 court métrage :
Oui, peut-être
de Maryline Canto
France | 2007 | 7′
Tard dans la nuit, elle a l’audace de le suivre…
Ce film se démarque vite par la qualité d’écriture de ses dialogues et par l’ambiguïté du personnage de la jeune fille. Sous ses allures de fan transie, elle s’avère être une critique redoutable du travail de son interlocuteur…
 Vendredi 14 juin à 2012 21h
Vendredi 14 juin à 2012 21h
ARGO
de Ben Affleck
avec Ben Affleck, Bryan Cranston et John Goodman
Etats-Unis | thriller | 2012 | 1h59
Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran et prennent 52 Américains en otage. Au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de « l’exfiltration » de la CIA (Tony Mendez) monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma…
Argo est tiré d’une histoire vraie qui a bien failli virer au drame. En 1979, une douzaine d’Américains avaient été pris en otages dans leur ambassade en Iran. Six d’entre eux étaient parvenus à s’échapper et à se cacher auprès de l’ambassadeur canadien Ken Taylor à Téhéran. La CIA a alors tout mis en œuvre pour les ramener chez eux. Anecdote étonnante : dans l’équipe de sauvetage se trouvait John Chambers, qui a reçu un Oscar spécial pour son travail de maquilleur sur le film La Planète des singes, et qui prêtait alors son atelier à des espions américains !
Le réalisateur Ben Affleck a tenu à ce que le film soit à la fois drôle et sérieux. Selon lui, Argo ne devait pas être trop léger, au risque de tuer tout suspense et intérêt du film. « Pendant le film, le public doit se soucier du sort des otages, et ne pas se dire que puisque le film est drôle, tout va bien se terminer », a-t-il déclaré. « Une partie du film est donc une satire comique de Hollywood, la deuxième est beaucoup plus sérieuse ».
3 Oscars en 2013 : Meilleur Film, Meilleur Scénario adapté et Meilleur Montage
César 2013 du Meilleur Film Etranger
Le meilleur thriller d’espionnage de l’année. Le Journal du Dimanche
Un film d’espionnage réaliste, haletant, drôle par moments, tendu à d’autres, excellemment interprété. Les Inrockuptilbles
Un polar inclassable et malin qui distille un suspense léché sans jamais se la raconter. Le Nouvel Observateur
Avec une virtuosité affolante, Affleck slalome entre les écueils d’un sujet casse-gueule, passe de l’absurde à la tension extrême en un mouvement de caméra. Première
1 court métrage :
The sick boy and the tree
de Paul Jaeger
France | 2009 | 3’52
Un jeune garçon malade s’accroche à son dernier espoir.
Doté d’une narration en rimes et en anglais, ce conte évoque le premier court métrage de Tim Burton, Vincent, une autre ode à l’imaginaire et au rêve.