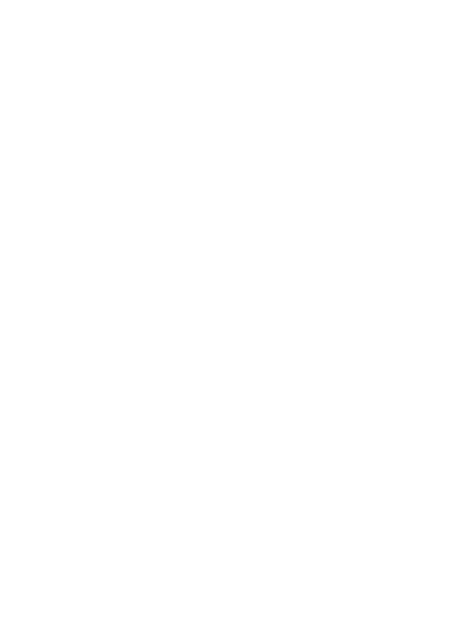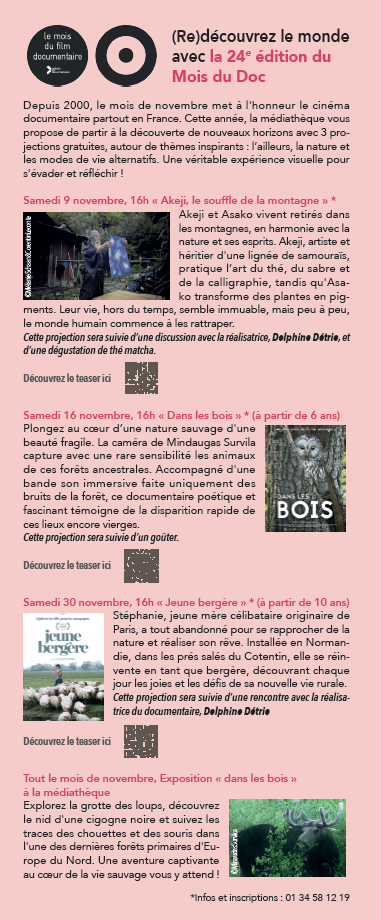
L’Art de James Cameron
Exposition produite par la Cinémathèque française
en association avec la Avatar Alliance Foundation
3 avril 2024 – 5 janvier 2025
La Cinémathèque française, Paris
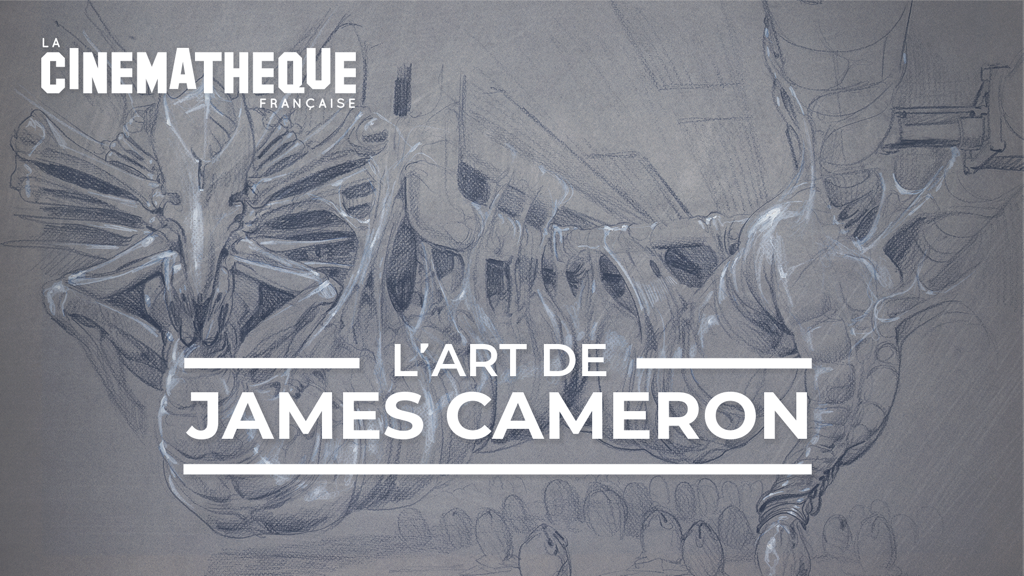 Voyage exceptionnel dans l’esprit d’un génie, L’Art de James Cameron décrypte la carrière et le processus créatif d’un des plus grands inventeurs du cinéma.
Voyage exceptionnel dans l’esprit d’un génie, L’Art de James Cameron décrypte la carrière et le processus créatif d’un des plus grands inventeurs du cinéma.
« Ayant grandi dans une petite ville du Canada, je dessinais constamment. J’étais inspiré par les comics, les livres de science-fiction et les films que je consommais avec voracité. Je me suis toujours considéré davantage comme un illustrateur dans l’âme qu’un artiste. J’utilisais mes dessins et mes peintures pour raconter des histoires. Et tout cela a constitué un entraînement parfait avant de passer à l’art cinématographique à la fin de ma vingtaine. » James Cameron
L’exposition célèbre le génie de James Cameron, l’un des plus grands réalisateurs, scénaristes, producteurs et inventeurs de tous les temps. L’Art de James Cameron offre aux visiteurs la traversée de six décennies d’une œuvre innovante. Elle réunit un éventail éblouissant et diversifié de pièces rares et inédites provenant de l’immense collection privée du cinéaste. Cette exposition, la première de cette envergure, met en scène et accompagne la trajectoire de ses idées, qui aboutirent à des films d’une grande modernité, devenus aujourd’hui des classiques, tels que Terminator, Aliens, Titanic ou Avatar.
La Cinémathèque française à Paris – en association avec la Avatar
Alliance Foundation – présente L’ART DE JAMES CAMERON, une
exposition conçue par Kim Butts et Matthieu Orléan.
Alors que James Cameron a créé et utilisé des technologies cinématographiques de pointe tout au long de sa carrière, son processus créatif a commencé avec un stylo, un crayon et un pinceau bien avant qu’il ne touche à une caméra. L’Art de James Cameron inclut la totalité de son œuvre, de ses premiers croquis à ses opus les plus récents et acclamés, en passant par des projets non réalisés. En parcourant l’ensemble de ses dessins et peintures, les visiteurs découvriront et comprendront comment des idées, des thèmes et même certains motifs spécifiques ont fini par figurer dans des scènes de films désormais cultes, emblématiques d’un cinéma spectaculaire n’ayant pas peur du faste. L’exposition donnera également accès à des commentaires très personnels, écrits et oraux, du cinéaste sur sa propre évolution créative et artistique.
Cameron a fait preuve d’un talent remarquable dès son plus jeune âge, remplissant ses carnets de croquis de créatures extraterrestres, de mondes imaginaires et de merveilles technologiques. En grandissant, son art est devenu de plus en plus sophistiqué, explorant des thèmes à ses yeux primordiaux qui imprègneront ultérieurement son travail : ainsi, la menace d’une catastrophe nucléaire ou les dangers inhérents au développement de l’intelligence artificielle. Œuvrant dans l’industrie cinématographique dès sa vingtaine, Cameron a commencé par subvenir à ses besoins en réalisant des affiches et en tant que chef décorateur pour des films à petit budget. Il a ainsi pu affiner ses propres concepts et consolider sa puissance visionnaire, ce qui lui permettra d’obtenir le feu vert pour la réalisation de son premier long métrage, Terminator.
Cet univers éblouissant, que présente L’Art de James Cameron, sera divisé en six parties thématiques : « Rêver les yeux grands ouverts », « La Machine humaine », « Explorer l’inconnu », « Titanic : remonter le temps », « Créatures : humains et aliens », « Les Mondes indomptés ».
Plus de 300 œuvres originales seront présentées dans l’exposition : aussi bien des dessins, pastels, peintures que des accessoires, costumes, photographies et dispositifs 3D conçus ou adaptés par Cameron lui-même, passionné de technologie dans tous les champs de la création qu’il investit. La recherche inépuisable, que mène Cameron, de nouvelles techniques créées pour les besoins artistiques de ses films, ponctuera l’exposition par le truchement d’importants dispositifs expérientiels multimédias.
L’exposition L’Art de James Cameron est une « autobiographie de son art », ainsi que Cameron qualifie son œuvre aujourd’hui rassemblée, unique expérience d’une trajectoire et d’un processus créatifs exceptionnels.
Commissaires de l’exposition :
Kim Butts est la directrice créative de la Avatar Alliance Foundation
Matthieu Orléan est collaborateur artistique à la Cinémathèque française
Coordination curatoriale : Brooks Peck
Lien pour découvrir l’expo James Cameron à la Cinémathèque